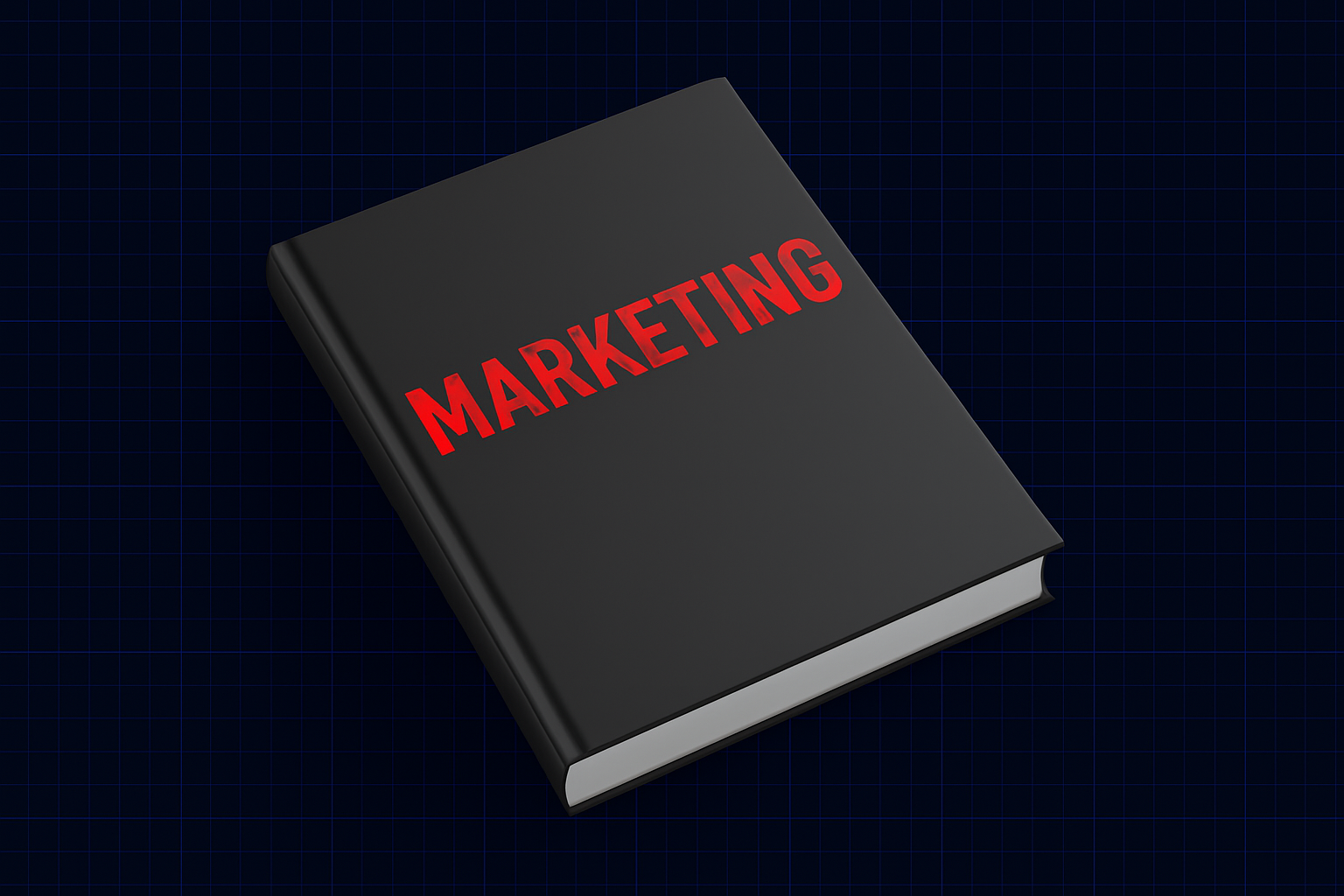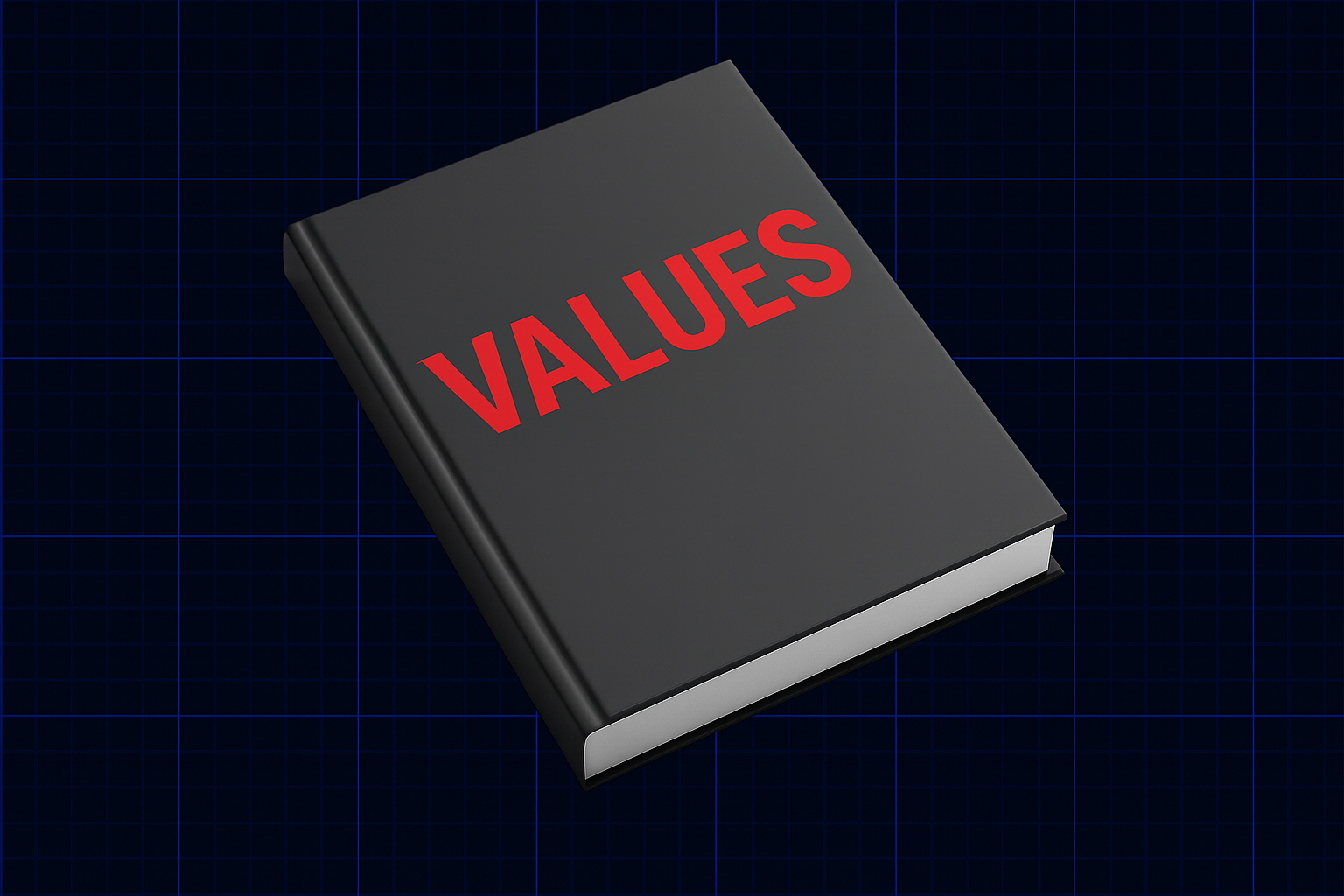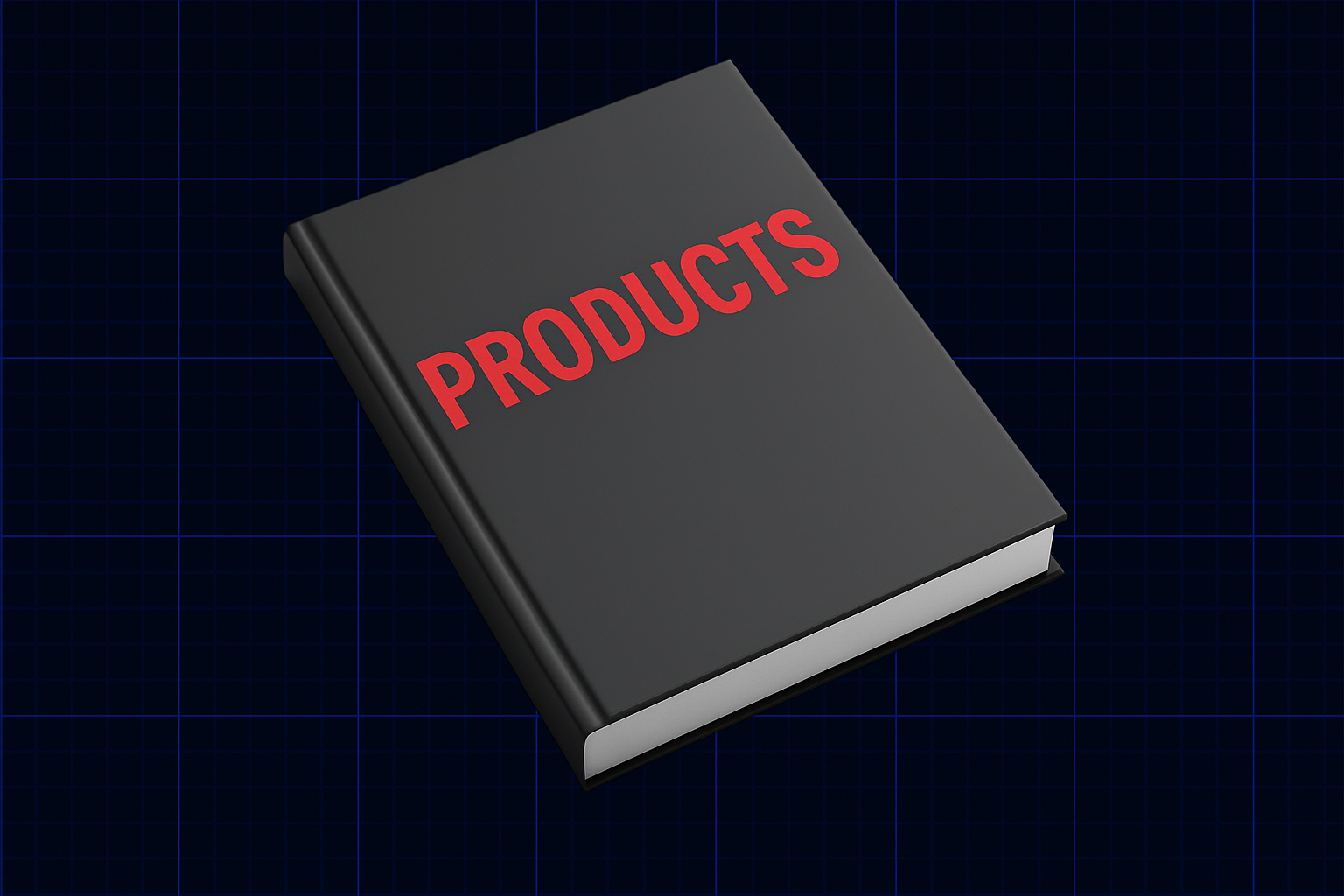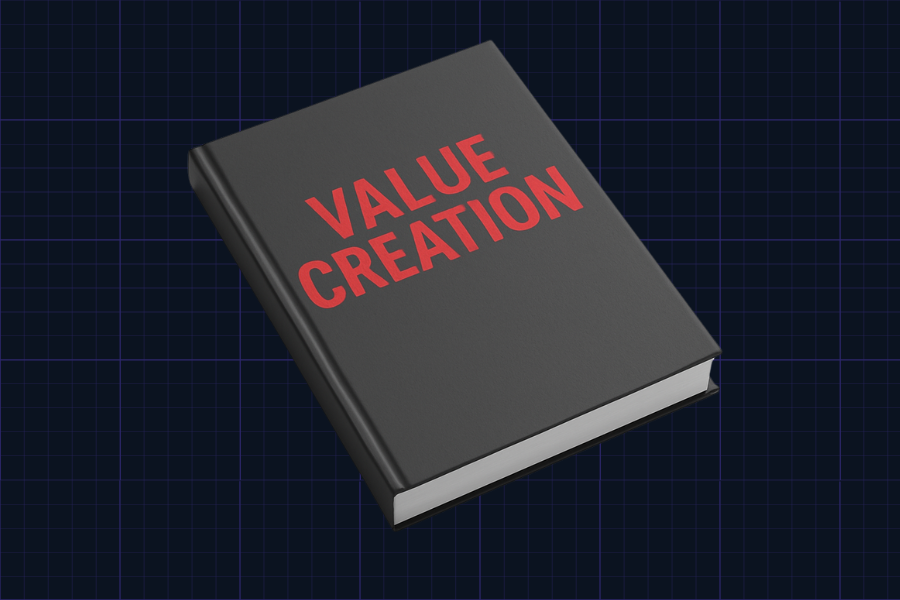Il suffit de tendre l’oreille dans une conférence business, une salle de réunion ou un podcast de start-up pour entendre ce mot sacré : valeur.
Créer de la valeur. Délivrer de la valeur. Capturer la valeur.
C’est le mantra moderne du capitalisme éclairé.
Mais il y a un problème : tout le monde en parle, très peu en créent vraiment.
Créer de la valeur n’est pas publier un carrousel LinkedIn ou lancer une app en no-code.
Ce n’est pas non plus promettre un futur désirable dans une keynote ou vendre des produits fabriqués en dropshipping en se cachant derrière un storytelling éthique.
La majorité des projets entrepreneuriaux qui clament “changer la vie des gens” ne passent même pas l’épreuve de la friction réelle : pas d’usage répété, pas de bouche-à-oreille, pas de rachat.
Autrement dit, pas de transformation.
C’est de la daube (c’est pas gentil pour la daube, parce que c’est quand même très TRÈS bon).
L’illusion du storytelling entrepreneurial
Aujourd’hui, l’entrepreneuriat est devenu un art narratif.
On vend un récit avant même d’avoir une offre. On se met en scène. On met des mots comme “impact”, “solution”, “communauté” en surbrillance, et on pense que ça suffira.
Mais la valeur ne se déclare pas : elle se constate.
Elle n’est pas dans la promesse mais dans l’usage.
Pas dans le pitch mais dans la répétition.
Créer de la valeur, ce n’est pas faire un produit.
C’est provoquer un changement dans la vie réelle de quelqu’un.
Avoir une “belle idée” n’a jamais suffi.
Comme disait Paul Graham : “Make something people want…”
sauf que voilà, les gens sont des ânes (bâtés) ne savent pas toujours ce qu’ils veulent.
Le paradoxe fondateur : “faire ce que les gens veulent” vs “créer ce qu’ils ne savent pas encore vouloir”
Tu veux vraiment créer de la valeur ? Tu vas devoir te positionner sur une ligne de crête.
D’un côté, répondre à une demande explicite : c’est la voie de la sécurité, des modèles validés, des marchés existants.
De l’autre, révéler une envie latente, un besoin non encore formulé : c’est la voie du visionnaire, de l’artiste, du fou.
Mais les deux extrêmes sont piégés.
Faire ce que les gens veulent : c’est souvent leur donner ce qu’ils connaissent déjà.
Créer ce qu’ils ne savent pas encore vouloir : c’est courir le risque qu’ils ne veuillent jamais.
La vraie valeur émerge entre ces deux tensions.
Elle nécessite une intuition aiguisée, une capacité d’observation clinique, et surtout un ancrage radical dans le réel.
Créer de la valeur, ce n’est pas cocher une case de business plan.
C’est voir le monde autrement, y introduire une faille, et rendre cette faille désirable.
Bienvenue dans l’art difficile de ceux qui transforment le manque en levier, l’invisible en évidence.
Petit cas d’étude pas glorieux : SNAKKAR by Marcus Détrez
“J’avais toujours rêvé de créer mon propre centre de formation en langues étrangères.
Déjà en 2016, sur mon CV de bébé que je donnais à qui je pensais voudrait m’embaucher, je l’avais noté dans “Mes ambitions”.
J’ai profité du COVID, pour me lancer. De toute façon c’était ma passion et j’avais rien d’autre à faire.
Je me suis heurté à quelque chose de douloureux.
J’étais un prof d’anglais parmi 12 millions en France.
Pourtant je créais tellement de valeur avec mes BE + V-ing.
Oh wow.
Puis j’ai étudié mon marché, écouté mes cibles et … aujourd’hui mon centre de formation, pourtant business très traditionnel et qui serait perçu par beaucoup comme boring as fuck est devenu un Evergreen qui grandit sans moi et qui me paye mon quotidien.
Bref je te laisse lire.”
Marcus.
I. LA VALEUR : MYTHE, MARCHÉ ET MENSONGES
A. La loi de fer du marché : le marché a toujours raison
1. Le marché n’écoute pas les pitchs, il répond aux usages
Dans les arènes économiques, il n’y a ni jury bienveillant ni standing ovation pour une bonne intention.
Le marché est un champ de bataille froid. Il ne s’intéresse pas à ton pitch, à ton branding ou à la beauté de ton prototype. Il te donne une réponse binaire, brutale : quelqu’un paie, ou personne ne paie.
Et surtout : quelqu’un revient, ou personne ne revient.
C’est là que meurt la majorité des projets.
Pas par manque d’amour.
Pas par manque de compétence.
Par absence de réponse comportementale du réel.
On a éduqué une génération d’entrepreneurs à croire que le business, c’était de l’éloquence, du storytelling, du “why”.
Mais un marché, ce n’est pas une salle TEDx.
Un marché, c’est une séquence d’usages répétables dans un contexte donné.
Et ta plus belle idée n’est qu’un vœu pieux si elle ne s’inscrit pas dans un comportement stable, accessible et récurrent.
La croyance toxique la plus répandue dans les incubateurs et les écoles de commerce, c’est celle-ci :
“Si c’est utile, ça marchera.”
Erreur fatale.
L’histoire économique est remplie de produits utiles qui n’ont jamais trouvé leur public, et de produits futiles qui ont structuré des marchés entiers.
L’utilité est une hypothèse.
La preuve, c’est le paiement.
La vérité, c’est l’usage.
Si personne ne sort sa carte bleue, ce n’est pas parce que ton idée est trop novatrice ou que le monde n’est pas prêt.
C’est parce que tu n’as pas su t’aligner sur un usage désirable ou un désir activable.
Créer de la valeur, ce n’est donc pas résoudre un problème objectif.
C’est rentrer dans une logique d’échange subjectif, où ce que tu proposes a plus de poids émotionnel et pratique que ce que les gens possèdent déjà.
Ce n’est pas la logique qui gouverne le marché.
C’est la transaction.
Et la transaction n’a qu’une règle : est-ce que ça vaut la peine, ici et maintenant ?
Le reste n’est que discours.
2. Exemple : la Google Glass, ou comment échouer avec un produit brillant
La Google Glass, c’était une démonstration de puissance.
Un concentré d’innovation logé dans une monture futuriste.
Caméra embarquée, commandes vocales, réalité augmentée : tout y était.
Et sur le papier, ça faisait rêver.
Mais le marché ne s’achète pas avec un rêve d’ingénieur.
Et la suite, on la connaît : flop commercial, rejet médiatique, surnom moqueur “Glasshole” donné à ses utilisateurs.
Pourquoi ?
Pas parce que le produit était mal conçu.
Mais parce qu’il violait des codes sociaux invisibles.
La Google Glass a été pensée comme une extension du cerveau.
Elle a été perçue comme une intrusion dans l’intimité collective.
Personne ne voulait être filmé en permanence par un inconnu dans le métro.
Personne ne voulait porter un signe ostentatoire de supériorité techno.
Trois erreurs majeures :
- Erreur de lecture sur le statut
L’objet était perçu comme prétentieux, élitiste, inaccessible.
Ce n’était pas un accessoire cool, c’était un stigmate. - Erreur sur la privacy
La caméra intégrée a déclenché une réaction de rejet instantanée.
Le produit créait du malaise, pas de confort. - Erreur sur l’usage réel
En dehors des démonstrations marketing, les cas d’usage étaient flous.
Pas assez de valeur ajoutée par rapport à un smartphone.
Trop cher, trop étrange, trop marginal.
Ce que la Google Glass a démontré malgré elle, c’est ceci :
La valeur perçue n’est pas liée à la performance technologique.
Elle est contextuelle, émotionnelle, statutaire.
Et dans un monde où l’attention est rare, tu n’as pas le droit à une deuxième impression.
L’innovation n’est pas une excuse.
Le marché ne récompense pas la sophistication.
Il récompense ce qui s’intègre dans les usages humains, avec discrétion, désir, et évidence.
3. Notions clés
▪ Loi de réalité du marché
La seule loi qui compte : celle du terrain.
Tu peux avoir raison trop tôt, ou raison tout seul ça ne te mènera nulle part.
Comme le disait Keynes, “les marchés peuvent rester irrationnels plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable.”
Traduction : si le marché ne te suit pas, tu as tort, même si tu as raison en théorie.
La vérité du marché n’est ni morale, ni logique. Elle est liquiditaire. Elle se mesure en euros, en flux, en conversions.
Tout le reste est romantisme de PowerPoint.
▪ Assomptions critiques
Chaque business repose sur des croyances.
“Les gens vont vouloir ça.”
“Les utilisateurs accepteront ce prix.”
“Il y a un besoin latent.”
Ces hypothèses, si elles s’effondrent, tout s’effondre.
Et pourtant, 90 % des fondateurs les formulent mal, ou pire, ne les testent jamais.
Une assomption critique, c’est ce qui doit être vrai pour que le modèle tienne debout.
Et tant que ce n’est pas testé dans le dur, tu vis dans une fiction.
▪ Validation comportementale
Tu veux savoir si ton offre a de la valeur ? Ne demande pas aux gens ce qu’ils pensent.
Observe ce qu’ils font.
L’intention ne vaut rien sans engagement.
Le like ne vaut rien sans clic.
Le clic ne vaut rien sans achat.
Et l’achat ne vaut rien sans récurrence.
Valider une idée, ce n’est pas envoyer un sondage.
C’est créer une situation où quelqu’un met du temps, de l’argent ou du risque sur la table.
Et voir s’il le fait sans qu’on ait besoin de supplier.
La création de valeur commence là :
Quand ce que tu proposes modifie un comportement réel.
Pas avant.
II. LES CINQ PILIERS DE LA MACHINE À VALEUR
A. Création de valeur : créer ou révéler ?
Créer de la valeur est devenu un slogan.
Mais ce que peu comprennent, c’est que la valeur n’est pas une production, c’est une révélation.
La majorité des “créateurs” tentent de faire exister une chose dans le vide, alors que les plus efficaces détectent ce qui est déjà là : une tension, un inconfort, une impatience collective.
Créer, c’est capter cette vibration cachée et lui donner une forme consommable.
C’est l’art d’offrir ce que les autres attendaient sans le formuler.
1. Critique des 12 formes standards de valeur
Josh Kaufman propose 12 formes standards de valeur : produit, service, abonnement, capital, agence, revente, assurance, prêt, option, ressource partagée, agrégation d’audience, leasing.
C’est une base utile. Mais elle rate le cœur du sujet : le vécu subjectif de la valeur.
Deux entrepreneurs peuvent vendre un abonnement.
Mais l’un vend de la distraction (Netflix), l’autre de la transformation (MasterClass).
Même forme. Impact différent. Valeur perçue radicalement distincte.
Les 12 formes n’expliquent ni :
- comment la valeur est ressentie
- ni comment elle s’intègre à la vie quotidienne
Elles décrivent ce qui est vendu, pas ce qui est vécu.
Ajout critique : Ce que Kaufman omet, c’est la géométrie émotionnelle de la valeur.
Un bien peut être fonctionnel (Uber Eats) ou rituel (pain de ton artisan préféré).
Un service peut être transactionnel ou transformationnel.
La vraie valeur naît quand le produit devient une extension de soi, pas juste une solution externe.
2. Offre visible vs offre intégrée
La majorité des offres sont visibles : elles ont une marque, une landing page, une promesse.
Mais la vraie puissance se cache dans les offres intégrées.
Ce sont celles qui disparaissent dans la vie de l’utilisateur tout en étant devenues indispensables.
❖ Offre visible :
Tu achètes un produit. Tu l’évalues. Tu décides si tu continues.
Tu restes acteur rationnel.
❖ Offre intégrée :
Tu vis avec le produit. Il te structure. Tu ne peux plus revenir en arrière.
Tu deviens corps embarqué dans un système.
Spotify, Notion, Slack, Airbnb…
Aucune de ces offres ne vend un produit au sens classique.
Elles vendent une expérience fluide, un style de vie opérationnel, une structure mentale.
Créer de la valeur, ce n’est pas livrer un truc en boîte.
C’est créer une zone d’influence permanente dans l’environnement cognitif du client.
3. Notions clés à intégrer
Forms of Value (à détourner)
- Ne pas les prendre comme des “modèles”, mais comme des vecteurs de pénétration stratégique dans un marché.
- Chaque forme doit être customisée à ton ADN. Ne jamais copier telle quelle.
Modularity
- Ta valeur doit être démontable.
- Si elle est monolithique, elle devient rigide, non scalable, non testable.
- Proposer une brique unique à forte densité permet d’itérer vite. (ex : un template téléchargeable, une routine d’appel, un module 1:1)
Exemple : au lieu de vendre “un programme d’accompagnement”, vendre :
- l’accès à la méthode
- un sparring partner stratégique
- des feedbacks tactiques
- la communauté
Et laisser chacun choisir ce qu’il active ou non.
Bundling
- Le bundle ne sert pas à gonfler la facture. Il sert à augmenter la valeur perçue par effet d’écho.
- Ce qui est bundle = ce qui est reconnu comme cohérent + désiré.
- Les meilleurs bundles ne sont pas mécaniques. Ils sont symboliques.
Exemple : vendre un logiciel d’édition audio + une masterclass sur la voix + 2 séances de coaching vocal.
Ce n’est pas un pack. C’est une narration de puissance.
Créer de la valeur n’est pas un acte linéaire.
Ce n’est pas “j’ai un produit → je le vends”.
C’est un processus en spirale :
tu observes – tu révèles – tu intègres – tu découpes – tu amplifies.
La vraie valeur se reconnaît à sa capacité à déranger les habitudes, réorganiser des priorités, et transformer le quotidien sans qu’on s’en rende compte.
Créer de la valeur, ce n’est pas créer un objet.
C’est créer un environnement mental dans lequel ton client devient une version différente de lui-même.
Et ça, aucune liste standardisée ne peut le prévoir.
B. Marketing : capter l’attention, avant de vendre
Tu peux avoir le meilleur produit du monde.
Tu peux délivrer une vraie transformation, avoir des clients heureux, un branding élégant.
Mais si personne ne regarde, tu n’existes pas.
C’est ici que beaucoup tombent : ils pensent que la qualité parle d’elle-même.
Elle ne parle jamais seule.
La qualité sans attention est une conversation muette dans une pièce vide.
Pourquoi Snakkar échouait à capter, même avec un bon produit
Au lancement, Snakkar cochait les bonnes cases pédagogiques :
- des formateurs natifs,
- des méthodes sérieuses,
- une approche interculturelle rare,
- une promesse claire : progresser en langues vivantes avec du vrai contenu.
Mais malgré cela, aucune traction spontanée.
On communiquait comme des profs, pas comme des snipers de l’attention.
Aucun élément saillant, aucun levier émotionnel, aucun effet miroir activé.
Ce n’était pas un problème de qualité, c’était un problème de perception initiale.
On était dans la bonne pièce, mais personne ne regardait dans notre direction.
Depuis, la stratégie a changé :
- contenu verticalisé par langue et par cible,
- visuels à rupture, ton incarné, contenu-miroir,
- tunnels émotionnels simples : “Tu veux parler japonais ? Voilà pourquoi tu n’y arrives pas.”
La valeur est restée la même.
Mais la mise en tension attentionnelle a tout changé.
C’est là qu’on a compris que le marketing ne vient pas après l’offre. Il est l’amorce.
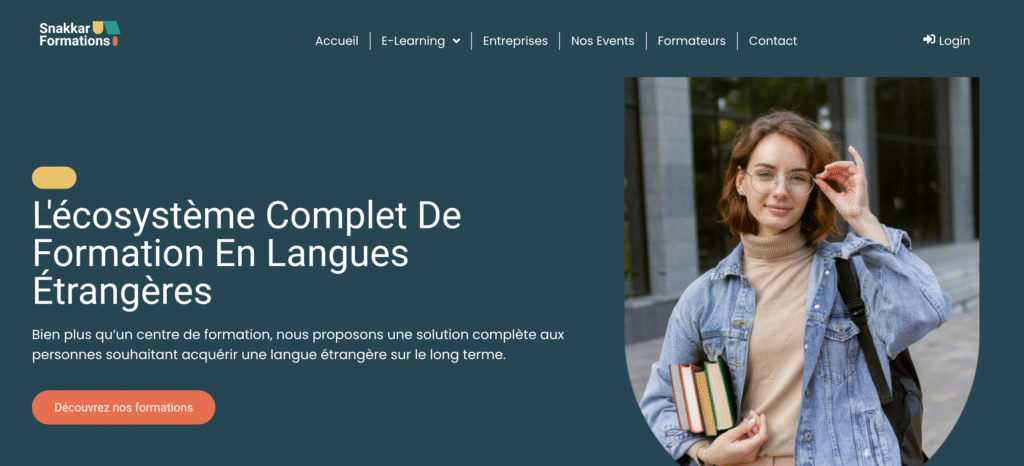
L’attention comme première devise (et première dette)
Avant l’argent, il y a l’attention.
Et cette attention est devenue la devise la plus chère du monde.
Tu n’as pas trente secondes.
Tu as trois mots, trois pixels, trois battements d’algorithme pour créer une fracture cognitive chez ta cible.
Pas pour l’informer. Pour le hacker.
Et même si tu l’obtiens, tu es redevable.
Chaque seconde d’attention captée est une dette narrative que tu dois rembourser par de la clarté, de la tension, ou une promesse activable.
La dette d’attention, mal remboursée, se transforme en rejet.
Le bon marketing ne dit pas “regarde-moi”.
Il dit “je sais exactement ce que tu vis. Et j’ai une sortie.”
Notions clés
▪ Audience Aggregation
C’est l’art de construire un espace où une cible se reconnaît collectivement,
et où tu deviens le centre gravitationnel d’un problème partagé.
C’est créer un média, pas juste une offre.
Un repère, pas juste une pub.
Snakkar est passé d’un site de cours à une zone culturelle identifiable.
C’est là qu’a commencé le vrai marketing.
▪ Hassle Premium
Tu veux capter ?
Alors montre à quel point tu peux réduire l’effort, la confusion, la saturation mentale.
Les gens ne paient pas pour apprendre une langue.
Ils paient pour ne plus se sentir humiliés en voyage,
ne plus perdre de temps sur des apps inutiles,
ne plus avoir peur de parler.
Le premium que tu captes, ce n’est pas celui de la valeur objective.
C’est celui du soulagement subjectif.
Celui qui dit : “Tu vas arrêter de galérer.”
Si tu veux créer un business viable, ne demande pas d’abord : “quelle est ma promesse ?”
Demande : “où est l’attention disponible, et pourquoi moi ?”
Parce que dans le réel, ce n’est pas celui qui délivre le mieux qui gagne,
c’est celui qui est vu le premier et qui tient la dette attentionnelle jusqu’à conversion.
C. Vente : transformer l’intention en transaction
Il y a un gouffre entre quelqu’un qui te dit “c’est une super idée” et quelqu’un qui sort sa carte bleue.
Ce gouffre, c’est la vente.
Et la plupart des projets s’y noient.
Tu peux inspirer, captiver, informer.
Mais si tu ne sais pas transformer cette tension en acte, tu restes dans l’évangélisation.
Pas dans le business.
Le passage de la théorie à l’argent
Ce moment-là, où la main se tend vers le portefeuille,
où l’écran affiche “confirmation de paiement”,
c’est le moment de vérité.
Tout ce qui précède branding, pitch, storytelling, landing page, communauté n’a de valeur que s’il aboutit à ça : une transaction.
Et une transaction, ce n’est pas une promesse.
C’est une preuve.
Vendre, ce n’est donc pas manipuler.
C’est révéler la clarté d’un besoin à travers une proposition tellement évidente que la peur recule.
Vendre = capter l’instant de vérité
Chaque prospect vit dans une tension : “j’aimerais, mais…”
Ta mission, ce n’est pas de l’écraser.
C’est de toucher exactement le point de bascule :
le moment où le gain perçu devient supérieur à l’effort supposé.
C’est là que se joue la vente.
Pas dans les features, mais dans la narration micro-secondaire du passage à l’acte.
Tu peux faire 90 % du parcours parfaitement.
Mais si tu rates l’instant de vérité mauvaise offre, timing flou, dernier doute non levé tu perds.
Notions clés
▪ Sales
La vente est une séquence dynamique : tension, validation, réduction de risque, passage à l’acte.
Ce n’est jamais statique.
Et ça ne se fait jamais “au feeling”.
C’est une architecture mentale, scénarisée et testée.
Celui qui maîtrise la vente ne vend pas un produit.
Il vend une transformation imminente, rendue accessible maintenant.
▪ Shadow Testing
Tu ne sais pas si ton offre est vendable ? Ne demande pas.
Vends-la avant de l’avoir.
C’est la base : tu places ton produit dans le monde comme s’il existait déjà, et tu regardes si quelqu’un s’engage.
Un bouton “acheter maintenant” avec un vrai formulaire.
Un tarif visible.
Une friction minimale.
Ce n’est pas immoral si tu es clair.
C’est le seul test valable.
Parce que les gens mentent, les comportements non.
▪ Barrières à l’achat
Si la vente ne se fait pas, ce n’est pas forcément un problème d’intérêt.
C’est souvent un problème de frein non levé.
Voici les principaux :
- Flou sur l’offre : je ne comprends pas ce que j’achète.
- Méfiance : je ne sais pas si je peux te faire confiance.
- Manque de projection : je ne me vois pas dedans.
- Trop de choix : je suis paralysé.
- Pas assez urgent : je le ferai plus tard (et donc jamais).
Ton job, ce n’est pas de convaincre.
C’est de lever chaque barrière une à une, comme une opération commando.
La vente, ce n’est pas la suite logique du marketing.
C’est un territoire à part entière, avec ses lois, ses pièges, ses points de bascule.
Et si tu ne sais pas le traverser, tu restes dans l’admiration. Pas dans la transaction.
D. Livraison de valeur : le vrai test du terrain
Tu as convaincu.
Tu as vendu.
Félicitations : le piège est tendu.
Parce que maintenant, il faut livrer.
Et c’est là que la majorité s’écrase.
Dans un monde saturé de promesses, livrer ce que tu as promis ne suffit plus.
La vraie valeur se joue dans l’écart entre l’attendu et le vécu.
Tu veux créer une relation, un actif, une confiance ? Il va falloir dépasser.
L’art de livrer plus que ce qu’on promet
La livraison, c’est la scène finale du spectacle.
Tu as fait venir ton prospect dans la salle, tu as suscité l’attente, généré le désir.
Mais si ce qu’il vit est déceptif, il ne reviendra pas.
Aujourd’hui, on ne juge plus une offre au moment de la vente,
mais au moment de la répétition, de la recommandation, ou du silence.
Promettre, c’est séduire.
Livrer, c’est incarner.
Et incarner, c’est montrer que tu n’étais pas là pour une seule danse.
Ceux qui gagnent ne sont pas ceux qui font le plus de bruit avant.
Ce sont ceux dont les clients parlent encore après.
Cas Compagnons : promesse de visibilité vs exécution lente
Le projet Compagnons a été conçu pour une noble cause :
rendre visibles ceux qui ne savent pas se vendre eux-mêmes artisans, créateurs, travailleurs de l’ombre.
La promesse était forte.
L’adhésion rapide.
Mais la livraison fut lente. Trop lente.
Pourquoi ?
Parce qu’on avait sous-estimé le poids de l’attente perçue.
Un artisan à qui on promet de la visibilité en a besoin maintenant, pas dans six mois.
Et même si l’outil final était bon, le décalage entre promesse et temporalité a créé une dissonance.
Résultat ? Un bon produit, mal vécu.
Une valeur réelle, mais mal incarnée.
Et donc, une valeur affaiblie.
Ce n’est pas la compétence qui manquait.
C’est l’épreuve du feu qui a été évitée trop longtemps.
Il manquait un test terrain brutal, un feedback immédiat, une friction réelle.

Notions clés
▪ Value Delivery
Ce n’est pas livrer ce que tu as vendu.
C’est livrer ce que l’autre pense avoir acheté.
Et souvent, c’est plus.
Une offre livrée avec une latence, une approximation ou un doute annule tout l’effort de marketing et de vente.
La cohérence perçue de l’expérience vaut plus que la somme de ses parties.
▪ Field Testing
Ne jamais croire que ton système est prêt avant de l’avoir mis en tension réelle.
Une livraison, c’est un muscle.
Et un muscle, ça se teste sous charge.
Tu veux savoir si ton produit ou service tient la route ?
Mets-le entre les mains de vrais utilisateurs dans des conditions réelles.
Et regarde ce qui casse.
Tu veux créer une machine fiable ? Commence par l’abîmer toi-même.
Si elle survit à ça, elle survivra au reste.
▪ Iteration
Livrer de la valeur, ce n’est jamais figé.
C’est itérer en boucle, en live, en flux.
Chaque livraison est une hypothèse testée.
Chaque retour est une mine de données.
Et ceux qui n’itèrent pas meurent dans l’égo figé de leur V1.
La livraison est le miroir sans filtre de ton projet.
C’est là que tout se paie ou se perd.
Pas d’excuses. Pas de storytelling. Pas d’itération mentale.
Soit la promesse devient matière, soit tu redeviens silence.
Et dans l’économie de l’attention,
le silence = la mort.
E. Finance : la seule vraie preuve que ça marche
Tu peux être admiré.
Tu peux être applaudi.
Tu peux même avoir des utilisateurs satisfaits.
Mais si ton projet ne dégage aucun flux financier structurant, tu n’as pas un business.
Tu as un hobby.
Et il n’y a rien de mal à ça.
Mais il faut avoir le courage de nommer les choses.
Un business existe parce qu’il survit.
Et pour survivre, il a besoin d’un cœur qui bat : le cash-flow.
Un business qui ne rapporte pas est un hobby
Tu connais ces projets “inspirants”, “communautaires”, “engagés” qui ne se paient jamais ?
Ils sont peut-être utiles.
Mais s’ils ne génèrent pas de revenus, ils dépendent éternellement d’un sacrifice humain.
Ce n’est pas du capitalisme.
Ce n’est même pas du social business.
C’est une dissolution lente dans la fatigue invisible de celui qui porte tout.
L’argent ne valide pas la valeur morale d’un projet.
Mais il valide sa capacité à durer dans le monde réel.
Sans revenus récurrents, tu es toujours à un burn-out ou une bourse près de t’effondrer.
Flux, marge, scalabilité : les trois chiffres qui décident de ta liberté
Un projet qui marche, ce n’est pas juste “ça tourne”.
C’est :
- Des flux réguliers, prévisibles, encaissés.
- Des marges nettes qui te permettent d’investir, de déléguer, de respirer.
- Une scalabilité maîtrisée : tu peux croître sans t’effondrer ni devenir esclave de ton modèle.
Il ne s’agit pas d’obsession comptable.
Il s’agit de survie stratégique.
Et surtout : de disponibilité mentale pour construire à long terme.
La finance n’est pas une fin.
C’est une condition minimale d’autonomie.
Notions clés
▪ Profit
Le profit n’est pas sale.
Le profit, c’est ce qui te permet de ne pas imploser quand la passion s’épuise.
C’est ce qui finance ta prochaine itération.
C’est ce qui te permet de refuser les partenariats toxiques.
Et c’est ce qui prouve que tu sais créer un échange équilibré.
▪ Minimum Viable Offer (MVO)
Tu veux tester ton modèle financier ?
Ne pars pas sur un business plan sur 5 ans.
Teste une offre minuscule, vendue réellement, à un vrai prix.
Un MVO, c’est la version la plus dépouillée d’une offre que quelqu’un est prêt à acheter maintenant.
Tu n’as pas besoin d’un produit parfait.
Tu as besoin d’un signal net : “Oui, je paie.”
Si personne ne paie pour ton MVO, ton projet est une spéculation émotionnelle.
▪ Sufficiency
L’idée n’est pas de maximiser à tout prix.
C’est de savoir ce qu’il te faut pour que le modèle soit viable.
Tu veux gagner ta liberté ? Calcule ton seuil de suffisance.
- Combien de clients ?
- Quelle marge ?
- Quelle récurrence ?
Et à partir de là, construis une stratégie qui finance ta souveraineté.
La finance est le seul indicateur que tu ne peux pas manipuler avec des effets de style.
Tu gagnes, ou tu perds.
Tu es solvable, ou tu t’écroules.
Et tant que ton projet ne génère pas de cash sans te tuer,
il n’est pas une entreprise.
C’est une fiction opérée à crédit.
Tu veux bâtir ?
Commence par rendre ton modèle monétisable.
Ensuite seulement, tu pourras parler d’impact, de vision et de mission.
Parce qu’un business qui dure, c’est un business qui n’a pas besoin d’être sauvé chaque trimestre.
III. L’ÉCHEC DE LA CRÉATION DE VALEUR : UNE TYPOLOGIE OPÉRATIONNELLE
On dit souvent qu’un projet échoue parce qu’il n’a “pas trouvé son marché”.
Mais c’est bien plus précis que ça.
Un projet peut échouer en créant de la valeur, mais sans jamais la transformer, la livrer ou la monétiser.
Il peut séduire, intriguer, rassurer… puis mourir dans un angle mort de l’exécution.
Voici une typologie opérationnelle de ces échecs.
Pas pour se moquer, mais pour les voir venir plus tôt.
A. Le hobby : pas de valeur créée
C’est le projet qu’on adore.
Celui dont on parle avec passion, qu’on développe en side-project, qu’on peaufine le dimanche.
Mais personne ne l’attend.
Il ne résout rien.
Il n’existe que pour soi.
Et c’est très bien tant qu’on ne se ment pas.
Si tu n’as pas d’utilisateur, pas de test, pas de transformation réelle…
Tu n’as pas un business.
Tu as un atelier personnel un hobby.
B. Le flop : pas d’attention captée
La valeur est peut-être là.
Mais elle n’émet aucun signal.
Le branding est flou.
Le discours est fade.
La cible ne se reconnaît pas.
Ce projet meurt dans l’indifférence, non dans l’échec technique.
C’est une pièce de théâtre montée avec brio… dans une salle vide.
C. La non-profit : pas de vente
Tu captes l’attention.
Tu apportes de la valeur.
Mais tu n’oses pas vendre.
Alors tu laisses tout gratuit.
Et tu bascules dans la logique du don, du “pour la communauté”, du “partage”.
C’est noble.
Mais épuisant.
Note personnelle :
J’ai vu des entrepreneurs, brillants, ne pas parvenir à vendre leur produit.
Plutôt que de le tuer, ils l’ont transformé en plateforme non-profit.
Objectif : “que ça serve au moins à quelqu’un”.Curieusement, même gratuit, le trafic n’est pas venu.
Parce que la gratuité n’est pas une stratégie : c’est parfois une compensation émotionnelle face à l’échec commercial.
Et surtout : sans revenus, pas de croissance, pas d’équipe, pas de marge de manœuvre.
Tu deviens esclave d’un projet qui ne te nourrit pas.
D. L’arnaque : pas de livraison
Ici, tout semble parfait.
L’attention est captée.
Les ventes se font.
Mais la valeur n’est pas délivrée.
Le produit est vide.
L’expérience est déceptive.
La promesse était du vent.
Le business tourne… mais il use la confiance comme carburant.
Et ça, c’est non seulement fragile, mais toxique pour l’écosystème entier.
C’est le cas classique des formations bullshit, des SaaS sans produit derrière, des plateformes pleines de promesses creuses.
À court terme, tu gagnes.
À long terme, tu pourris ton nom.
E. Le cadavre : pas de revenus
Tout semble être là.
Les utilisateurs viennent.
Le produit tourne.
La valeur est perçue.
Mais l’argent n’entre pas.
Tu as une structure.
Tu as une base.
Mais tu n’as aucun levier économique réel.
Tu as donc un zombie : un projet mort-vivant,
qui avance mécaniquement mais nourrit personne.
Tu relies tout à ton énergie personnelle, tu compenses à la main, tu espères un “tipping point”.
Mais ce point ne vient jamais.
C’est là que beaucoup de projets finissent.
Non pas dans l’échec, mais dans l’épuisement silencieux.
Échouer à créer de la valeur, ce n’est pas juste mal exécuter.
C’est souvent mal diagnostiquer où se situe l’interruption dans la chaîne.
À chaque étape création, attention, conversion, livraison, revenu tu dois tester, mesurer, itérer.
Sinon, tu risques de bâtir un mirage rentable en apparence,
mais qui ne tient rien, ne nourrit personne, ne dure jamais.
IV. STRATÉGIES POUR CONSTRUIRE UNE OFFRE QUI TIENT
Tu veux construire une offre qui dure ?
Une offre qui ne dépend pas de ton énergie personnelle, de la hype ou d’un financement providentiel ?
Alors ne commence pas comme tout le monde.
Oublie la cathédrale. Oublie le pitch parfait.
Et surtout : oublie l’idée brillante que tu as eue sous la douche.
Commence par le réel.
A. Commencer par le marché, pas l’idée
La majorité des entrepreneurs tombent amoureux de leur idée.
C’est la meilleure façon de ne jamais vendre.
Parce qu’une idée ne vaut rien tant qu’elle n’a pas rencontré un usage.
Ce que tu dois chercher, ce n’est pas une idée.
C’est une douleur visible, un désir activé, une action prête à se produire si tu mets juste la bonne offre au bon endroit.
▪ Utiliser le Shadow Testing
Tu veux savoir si ça va marcher ?
Ne demande pas.
Teste.
Tu crées une page. Tu poses une offre. Tu mets un prix.
Tu lances une pub ou tu envoies un message.
Tu regardes qui clique, qui paie, qui répond.
C’est brutal.
Mais c’est le seul feedback qui compte.
Tu veux éviter de te ruiner pendant 6 mois à développer une app ?
Fais un test d’atterrissage en une soirée.
Tu sauras tout de suite si quelqu’un mord.
Le shadow testing n’est pas une technique de growth.
C’est une démarche de lucidité.
▪ Confronter dès le départ avec la réalité
Tu veux construire quelque chose qui tient ?
Expose-le au réel dès que possible.
Montre-le.
Vends-le.
Fais-toi mal, tout de suite.
Un projet qui ne s’est jamais confronté au doute, au “non”, au silence,
n’a pas encore commencé.
B. Construire une itération, pas une cathédrale
L’erreur la plus courante : vouloir sortir LA VERSION FINALE.
Avec tout.
Design parfait. Fonctionnalités complètes. Branding chiadé.
Tu passes des semaines à polir une tour d’ivoire…
Mais personne n’y entre.
▪ Le risque de la vision monolithique
Plus ton projet est lourd à lancer, plus il est fragile.
Plus tu mets de temps avant de confronter ton offre, plus tu construis dans le vide.
Tu te crées un monde mental cohérent…
Mais déconnecté.
Un produit qui vit, c’est un produit qui s’adapte vite.
Pas un produit qui impressionne à la slide 12.
▪ Vitesse contre perfection : Iteration Velocity
L’itération, ce n’est pas du bricolage.
C’est une stratégie.
Tu observes → tu ajustes → tu testes → tu recommences.
Ceux qui itèrent vite :
- rencontrent leur marché plus tôt
- économisent du cash
- trouvent leur ton, leur voix, leur angle
La vélocité d’itération, c’est le tempo interne de ton projet.
Si tu mets 3 semaines à faire un changement, tu es déjà mort.
Si tu mets 3 heures, tu es vivant.
C. Créer de la valeur en modules
Tu n’es pas obligé de tout livrer d’un coup.
Tu n’as pas à offrir un “programme complet”, une “plateforme exhaustive”, une “solution intégrale”.
Tu dois offrir une première brique de transformation.
▪ Ne pas tout packager dès le départ
Tu veux faire une formation ?
Commence par un atelier live.
Tu veux lancer une app ?
Commence par un Google Sheet.
Tu veux vendre une méthode ?
Commence par un PDF ou une session 1:1.
Ton but : créer un effet cliquable.
Un petit module qui donne envie de continuer.
▪ Modularité comme levier de scalabilité et résilience
En construisant ton offre en blocs :
- Tu peux l’adapter à plusieurs cibles
- Tu peux la faire évoluer sans tout casser
- Tu peux créer des bundles, des offres dérivées, des upsells
C’est comme jouer au Lego :
tu changes les combinaisons sans jamais repartir de zéro.
Et surtout : tu réduis le risque.
Tu lances petit, tu testes, tu empiles.
Chaque module devient une preuve de valeur.
Tu veux une offre qui tient ?
Oublie les plans parfaits.
Cherche les frictions réelles, les paiements bruts, les retours secs.
Construis petit, ajuste vite, livre souvent.
C’est là que naissent les systèmes robustes.
Pas dans les business plans,
mais dans les itérations bien senties.
V. LA CRÉATION DE VALEUR COMME ACTE POLITIQUE
Créer de la valeur, ce n’est pas juste répondre à une demande.
C’est prendre part à une structure invisible.
C’est tracer des lignes dans le réel et décider : voilà ce que je considère important, légitime, vital.
Chaque choix de valeur est un acte de réorganisation symbolique.
Et donc, un acte politique.
A. Contre la dictature du ROI
Le ROI a été sacralisé comme l’unité de mesure absolue du projet.
Mais derrière cette idée, il y a une philosophie cachée :
“Tu n’as le droit d’exister que si tu rapportes plus que tu ne coûtes.”
On parle de projets, mais on pense en algorithme.
On pense en argent, mais on oublie le système de sens.
▪ L’apport de Von Mises : la valeur est en nous, pas dans la chose
Ludwig von Mises l’avait compris :
“La valeur n’est pas dans les choses, elle est dans l’homme.”
Ce que nous appelons “valeur” n’est pas objectif.
Ce n’est pas dans le produit.
C’est dans la perception, la relation, le contexte.
Et ça, aucun tableur ne peut l’anticiper.
Une ligne de code peut avoir plus d’impact émotionnel qu’un million investi.
Une communauté informelle peut créer plus de transformation qu’un service public.
▪ La vérité économique ne se trouve pas dans les tableaux Excel
Un modèle rentable peut être toxique.
Un projet non-rentable peut être fondateur.
Le tableau Excel te dira que l’action de groupe n’est pas “viable”.
Mais l’histoire te dira que c’est elle qui change les équilibres.
La création de valeur commence là où l’Excel échoue à décrire.
Dans la reconnaissance sociale, dans le soulagement intérieur, dans le sentiment d’appartenance.
B. Créer de la valeur, c’est prendre position
Tu choisis quoi rendre visible,
à qui donner du pouvoir,
quelle souffrance soulager,
quel imaginaire activer.
Tu ne fais pas qu’un produit.
Tu fais un statement.
▪ Chaque forme de valeur est un signal idéologique
Tu proposes un service gratuit ? Tu participes à une logique de communauté.
Tu factures très cher ? Tu affirmes une logique de distinction sociale.
Tu designes ton outil pour les débutants ? Tu paries sur l’accessibilité.
Tu crées un club fermé ? Tu encourages l’élitisme choisi.
Chaque décision est politique, même si elle se cache dans le produit.
▪ Citation critique : Descartes, Épicure ou Grothendieck
Épicure disait :
“Ce n’est pas ce que nous avons, mais ce que nous apprécions, qui constitue notre abondance.”
Appliqué au business : tu ne crées pas de la valeur en empilant des features.
Tu crées de la valeur en modifiant le rapport des gens à leur monde.
Et pour ça, il faut une position, pas une stratégie de pricing.
C. Le business comme contre-société
Le business peut être une arme molle.
Une contre-société.
Un écosystème parallèle où on redéfinit les règles du jeu.
▪ L’approche MUS : entreprise comme arme sociale
Quand j’ai fondé MARCUS UNLIMITED STUFF, ce n’était pas pour créer “une structure d’optimisation”.
C’était pour bâtir un réseau de résistance entrepreneuriale,
un centre névralgique pour lancer, réparer, soutenir, déclencher.
Je ne voulais pas dépendre de fonds, ni de cabinets, ni de bullshit.
Je voulais une base arrière stable, d’où je pourrais impulser mes projets et protéger mes partenaires.
Note personnelle :
Si j’ai choisi de créer une holding comme MUS, c’est parce que je ne voulais ni mendier des financements,
ni me travestir pour intégrer des structures existantes.
Je voulais un levier stratégique : une holding pour construire mes règles,
avec mes gens, dans mes temporalités.
▪ Capitalisme relationnel vs capitalisme extractif
Le capitalisme extractif ne cherche qu’un ROI :
extraire plus de valeur que ce qui est donné.
Le capitalisme relationnel, lui, installe une logique d’échange durable,
où le lien humain est plus structurant que la marge.
Chez MUS, on ne vend pas un “temps”.
On vend une puissance distribuée,
une présence,
un effet de levier.
Créer de la valeur, ce n’est pas suivre un marché.
C’est dessiner un monde dans lequel tu veux vivre.
Et si tu veux que ce monde existe, il faut le rendre soutenable, structuré, transmissible.
C’est ça, le cœur de toute entreprise politique :
créer un système de valeur qui n’a pas besoin d’être justifié.
Juste vécu.
Et transmis
CONCLUSION : Créer de la valeur, c’est surtout créer des hommes
Ce que l’on appelle “valeur” dans les tableaux, les pitchs ou les bilans,
n’est que l’ombre mesurable d’un impact réel sur des êtres humains.
Créer de la valeur, ce n’est pas simplement augmenter une marge ou multiplier des revenus.
C’est provoquer une transformation, aider quelqu’un à devenir plus libre, plus outillé, plus aligné.
C’est pourquoi la valeur n’est pas une variable financière.
C’est une variable humaine.
Être bâtisseur = créer des structures, pas juste des produits
Les opportunistes créent des produits.
Les extravertis créent des communautés.
Mais les bâtisseurs, eux, créent des structures.
Des systèmes reproductibles.
Des écosystèmes d’entraide.
Des environnements où les idées deviennent des pratiques.
Où les frictions deviennent des rituels.
Où l’invisible devient un socle.
Être bâtisseur, ce n’est pas empiler des offres.
C’est sculpter une architecture de vie autour d’une vision partagée.
Et ça, aucun modèle économique ne peut le modéliser parfaitement.
Parce qu’il s’agit moins de ROI que de rémanence humaine.
Dernier appel : “Ne cherche pas à faire de la valeur, sois de la valeur.”
Tu veux créer de la valeur ?
Alors commence par être une présence qui transforme.
Un acteur dont la posture seule donne envie d’élever le niveau.
Un système vivant qui tient même quand les outils tombent, même quand la hype passe.
La valeur ne se fabrique pas en laboratoire.
Elle s’incarne dans la clarté des intentions, la cohérence des gestes, la rigueur de la livraison, et la densité du lien.
Alors oui, tu peux suivre tous les frameworks.
Tu peux maîtriser les itérations, l’UX, les funnels.
Mais à la fin, la seule question qui compte est :
“Est-ce que j’ai laissé quelqu’un en meilleur état qu’il ne m’a trouvé ?”
Si oui, tu as créé de la valeur.
Si non, recommence. Mais cette fois, commence par toi.
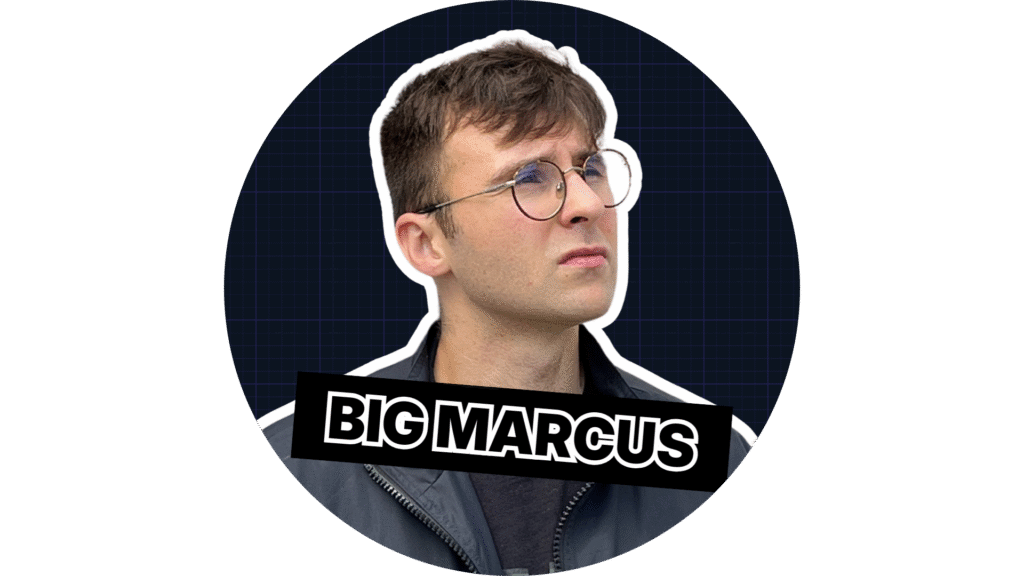
Marcus Détrez est un bâtisseur d’écosystèmes, fondateur de Marcus Unlimited Stuff. Il conçoit le business comme une forme de contre-pouvoir, mêlant stratégie, humanité et lucidité radicale. Entrepreneur multipreneur, il structure des offres utiles, politiques et durables. Chaque projet est pour lui un terrain de transformation, pas une simple opération.